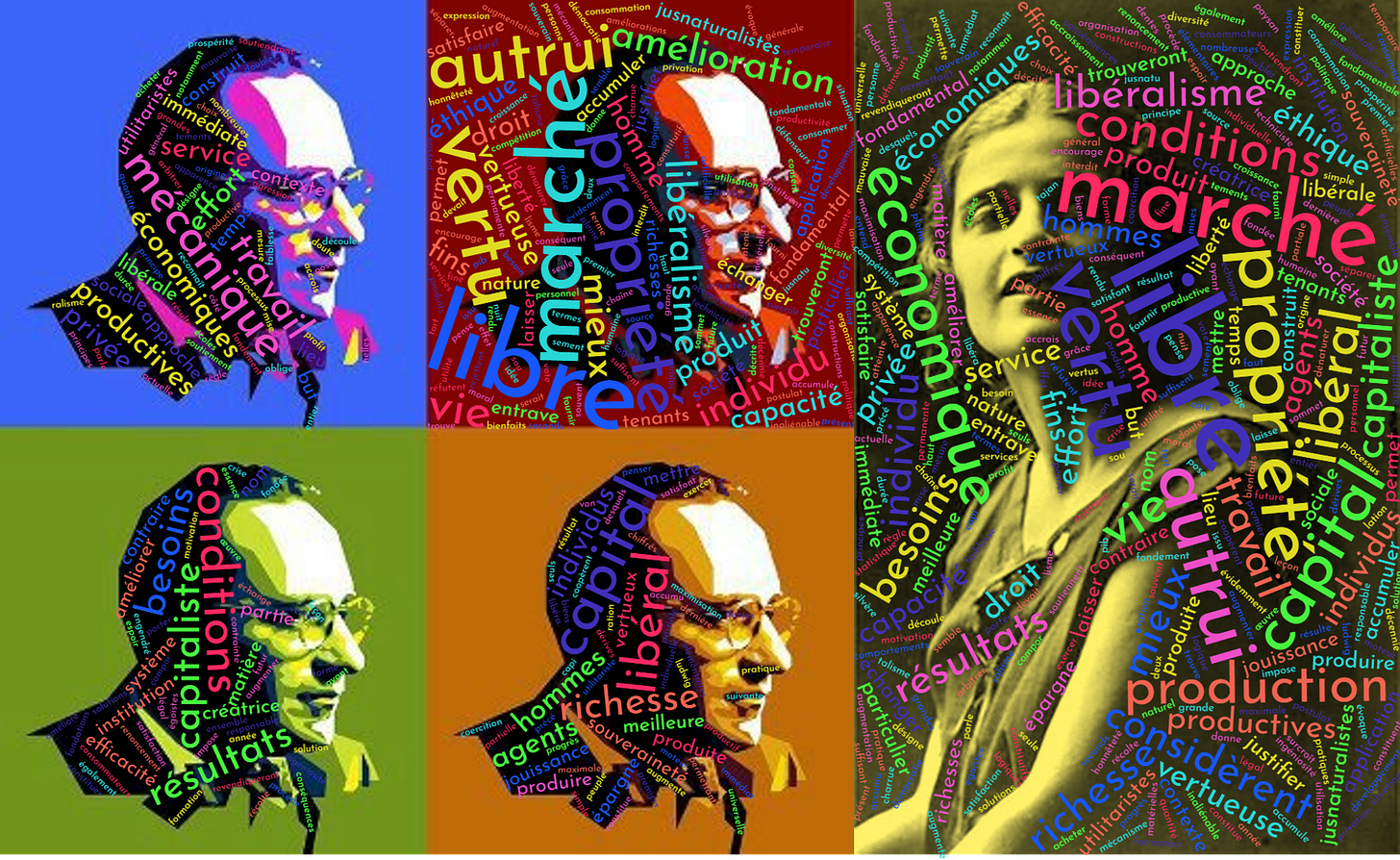La Liberté Manifeste - Chapitre 2 #2
Le droit naturel n’est naturel que parce qu’il est spontanément consenti par tous et chacun, émergeant socialement des consentements individuels.
(Suite de l’épisode précédent, ici.)
Iaenzen : Stéphane, dans une perspective libertarienne, qu’est-ce qu’on entend par “devoir” ? Pourriez-vous en donner une définition ?
Stéphane : Il n’y a aucun sens ni définition particulière donné à ce mot chez les libertariens, le devoir est à comprendre au sens commun, comme la réciproque du droit. Si vous et moi passons un contrat, librement, chacune des clauses dudit contrat établira des droits et des devoirs pour chacun de nous, tout simplement. Si vous venez chez moi, en ma propriété, mon droit est d’exiger de vous diverses règles ou comportements et si vous les acceptez, votre devoir est alors de les respecter.
La réponse semblant évidente, il me semble comprendre votre question comme plutôt centrée sur l’autorité qui se cache derrière le devoir. Autrement dit, qui est en mesure de faire respecter un tel devoir. Ce qui n’est autre que la question de la justice, supposée traitée par l’état régalien en démocratie, mais traitée tout à fait autrement en Libéralie. Encore une fois, la société libre, Libéralie, n’est pas une société de licence, où personne n’aurait de devoirs envers les autres, bien au contraire. Ce qui compte en Libéralie, c’est que ces devoirs résultent du plein et libre consentement individuel. Le devoir, c’est le fruit de l’engagement pris par l’individu responsable qui s’oblige à le respecter, en personne civile qui respecte sa parole.
Iaenzen : Stéphane, dans une perspective libertarienne, qu’est-ce qu’on entend par “responsabilité” ? Pourriez-vous en donner une définition ? Est-ce un synonyme de devoir ? Sinon, quelles seraient les différences ?
Stéphane : C’est en effet directement lié au devoir, comme il me semble y répondre à la question précédente. Cela vient bien sûr du latin, le devoir de “répondre de ses actes”, lorsque ceux-ci sont causes d’agression d’autrui. Là encore, il me semble que cette question triviale à la réponse évidente cache probablement un doute quant à la manière dont la responsabilité individuelle, analogue au devoir, se met en œuvre en Libéralie. Il y a divers mécanismes qui entrent en jeu, se soutenant mutuellement, notamment à partir de la réputation de chacun, incluant l’ostracisme et l’arbitrage. Nous verrons cela en détail quand nous traiterons de la justice en Libéralie.
Iaenzen : La doctrine du droit positif soutient que toute législation qui contredit la loi suprême (la Constitution nationale) n’est pas légitime. En suivant ce même raisonnement, pourrait-on dire que le droit positif, s’il respecte le droit naturel dans son intégralité, pourrait être légitime ?
Stéphane : Non, en aucune manière. Car il y a une contradiction profonde dans une telle conception. Le droit naturel n’est naturel que du fait qu’il est spontanément consenti par tous et chacun. Ce faisant, le droit émerge socialement à partir de la dynamique de tous les consentements individuels combinés. Comme le marché, c’est un ordre spontané. Le droit positif, par contre et par définition même du mot “positif”, est “posé”, c’est-à-dire postulé, décidé, déclaré, et surtout forcé puisque non spontané, précisément. Parce que forcé, il n’y a aucun moyen d’argumenter qu’il est consenti explicitement. Les légitimistes se gaussent que leur “Constitution” serait la clé de voûte, la cheville ouvrière portant la légitimité de tout leur édifice juridique. Mais dans la réalité démocratique, personne n’a jamais même la simple occasion d’exprimer son consentement, ou pas, à ladite constitution. L’hypothèse de départ de votre question, dont je ne conteste pas que certains la posent, ne tient donc pas.
De plus, pour ce qui tient à la seconde partie de la question, on ne peut pas dire que le droit positif respecte le droit naturel, c’est profondément contradictoire, là encore. Je dois noter que certains juristes m’opposeront probablement que le “droit positif” n’est jamais que “le droit qui est”, et qu’à ce titre, en faits, le droit positif est toujours dérivé du droit naturel fondamental qu’il concrétise. Mais cela est doublement faux.
Tout d’abord, comme on l’a vu, parce que la constitution qui est sa racine n’est en rien légitime. Mais aussi parce que le mécanisme législatif (au sens de “faire le droit”) est totalement différent entre les deux droits. Le concept de droit positif suppose un processus législatif, un pouvoir législatif, typiquement. Centralisé. Alors que le droit naturel est fait de façon parfaitement décentralisée, non pas par un pouvoir législatif, mais par les individus eux-mêmes en leur qualité de propriétaires libres d’échanger et chacun de nouer des contrats. Nous sommes en présence de deux concepts radicalement opposés de la “loi”. Celle du pouvoir centralisé de l’état face à celle décentralisée des individus libres. En Libéralie, les propriétaires font le droit.
Iaenzen : J’ai entendu dire, dans le débat académique, que le droit naturel (la “loi” naturelle), d’une certaine manière, a besoin d’une composante théologique pour se “justifier” ou pour se maintenir rhétoriquement. Autrement dit, l'hypothèse de l’existence de Dieu pourrait “faire comprendre” d’où émane la “loi” naturelle. Qu’avez-vous à dire à cet égard ?
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à Lettres de Libéralie pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.